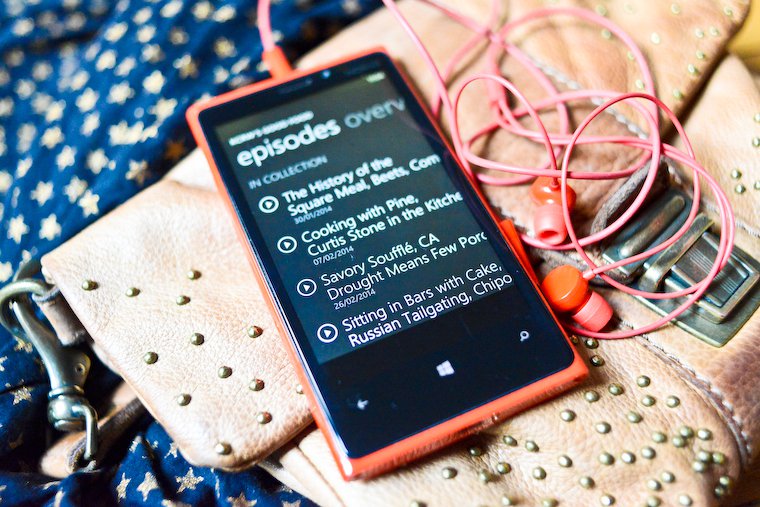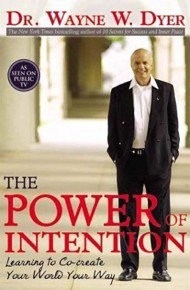Mes déjeuners en semaine, c’est ça : des salades toutes simples avec des céréales, des légumes frais, une source de protéine ou une autre, et des herbes fraîches. J’en prépare une bonne dose, et après je n’ai plus à m’en occuper pendant quelques jours.
J’essaie de varier les plaisirs pour éviter de manger tout le temps la même chose, mais je reconnais que je reviens souvent à celle-ci ces derniers temps : elle est pleine de saveurs, rafraîchissante mais satisfaisante, avec un bon mélange de textures entre le fondant des tomates et la mâche du petit épeautre.
Le petit épeautre (ou engrain), pour ceux qui ne l’auraient pas encore rencontré, c’est une céréale antique dont le nom latin est Triticum monococcum, à ne pas confondre avec son petit cousin le grand épeautre, ou Triticum spelta.
Le petit épeautre fut l’une des toutes premières céréales cultivées par l’homme* : riche sur le plan nutritionnel, elle s’épanouit sur les terres arides et montagneuses où pas grand chose d’autre ne pousse. Celui que j’achète, le petit épeautre de Haute Provence bio, est cultivé à cet endroit-là sous la même forme (c’est-à-dire sans croisement) depuis 9000 ans**. Il est protégé par une IGP et il est monté à bord de l’arche du goût du Slow Food il y a quelques années.
Evincé par des céréales à plus fort rendement il y a bien longtemps, le petit épeautre connaît un début de commencement de regain de popularité, en France et ailleurs, alors que ceux qui se soucient du contenu de leur assiette s’efforcent de ne plus dépendre uniquement du froment et explorent les alternatives. Par ailleurs, il a été suggéré que cette céréale, bien que contenant du gluten, pourrait être consommée par les personnes intolérantes. (Attention : il est trop tôt pour en être sûr et il faut attendre les résultats d’études supplémentaires.)
Le petit épeautre se trouve facilement dans les magasins bio qui m’entourent, mais si vous n’en trouvez pas, vous pouvez aussi faire cette recette avec du grand épeautre ou avec du farro (amidonnier en français), que je n’ai jamais vu commercialisé en France, mais qui est assez répandu en Amérique du Nord par exemple.
Si les tomates et le petit épeautre forment la base de cette salade, l’élément que je leur adjoint peut changer d’une fois sur l’autre : c’est très bon avec du tofu comme sur la photo, mais ça marche aussi très bien — peut-être même encore mieux — avec de la feta ou de la mozzarella. Vous remarquerez que j’y mets aussi une touche discrète de cannelle, parce que la tomate aime ça.
* Voir Alternative Wheat Cereals as Food Grains, G.F. Stallknecht, K.M. Gilbertson, and J.E. Ranney, 1996.
** Je vous recommande la lecture de cet entretien avec Etienne Mabille, producteur de petit épeautre en Haute-Provence.