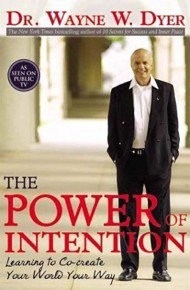La salade d’aujourd’hui est un peu le contrepoint hivernal de cette salade de tomates et petit épeautre de l’été dernier, ce qui montre probablement que ma relation avec le petit épeautre n’était pas qu’une amourette.
C’est une salade qui marie cette céréale ancienne (je vous renvoie à mon billet précédent pour en savoir plus sur la belle lisse-poire du petit épeautre) et ma courge d’hiver favorite, le potimarron, qui est ici rôti aux épices, avec pour témoins des échalotes, des herbes fraîches, et des noix.
C’est le genre de salade satisfaisante et aromatique avec un bon équilibre de textures dont je fais volontiers mon déjeuner, ou que je sers comme accompagnement. Je précise qu’elle voyage bien, donc on peut facilement l’emporter pour manger au bureau, ou à une fête chez un ami.
D’ailleurs, la première fois que je l’ai faite, c’était en guise de contribution au dîner que nos amis Derrick et Melissa ont organisé lorsqu’ils étaient de passage à Paris pendant la snowpocalypse début décembre, pour aller avec les magrets que Derrick prévoyait de faire rôtir.
Maxence l’a tellement appréciée que quand on est rentrés ce soir-là — après une traversée vivifiante de Paris en Vélib’ parce qu’on avait depuis longtemps laissé partir le dernier métro — il m’a demandé explicitement de noter ce que j’avais mis dedans, pour éviter que cette salade ne tombe dans le puits où finissent les bonnes idées qu’on a oubliées.
J’ai suivi son conseil et noté les grandes lignes dans mon petit carnet de cuisine, dont la couverture me fait sourire à chaque fois que je l’ouvre. Et j’ai très vite refait cette salade, d’abord avec un autre potimarron, puis avec une courge butternut qui passait par là sans se douter de rien, et à nouveau avec un potimarron pour notre soirée du nouvel an, où elle n’a pas ébloui nos amis autant que le magicien que nous avions invité, mais presque.