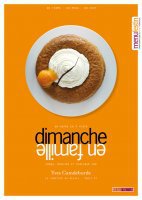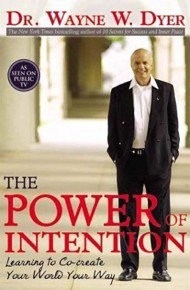Je suis une fan de recyclage culinaire.
Nombre de petits riens peuvent être mis à profit avec un peu de temps et d’astuce, et lorsque j’arrive à employer mes provisions au maximum de leurs possibilités — en faisant des soupes glacées avec les cosses des petits pois, du pesto avec les fanes des radis et des croissants aux amandes avec les croissants de la veille, en utilisant le petit lait de la mozzarella dans la pâte à pain, les tiges du persil dans les viandes mijotées et la croûte des fromages fermes dans les soupes — j’en retire une satisfaction infinie.
L’astuce du jour, je l’ai mise au point parce que ça m’ennuyait de jeter la peau des citrons quand je n’avais besoin ce jour-là que de leur jus.
L’idée est venue d’un pot de , séché et moulu, que j’avais acheté il y a des années, fabriqué par un producteur sicilien et simplement vendu sous le nom de buccia di limone (écorce de citron).
Le parfum et la saveur de cette poudre sicilienne étaient tels que j’ai mis des années à terminer le petit bocal, avant de réaliser enfin que je pouvais très bien en faire moi-même.
Le parfum et la saveur de cette poudre étaient tels que j’ai mis des années à terminer le petit bocal — il n’était pas donné, et j’ai souvent du mal à utiliser les ingrédients qui me semblent rares et précieux — avant de finalement réaliser que je pouvais très bien en faire moi-même.
Comment préparer le zeste de citron torréfié
La méthode est simple : avant de presser les citrons, je prélève le zeste en rubans à l’épluche-légume. Je les laisse sécher à l’air libre, puis je les fais torréfier à four doux avant de les réduire en poudre au mortier, ce qui dégage d’ailleurs une odeur de tarte au citron redoutable.
Comme j’ai peu de zestes de citron à torréfier à chaque fois et que l’idée est d’être économe, je profite de mon utilisation du four pour autre chose, et j’y mets les zestes pendant qu’il préchauffe : ceci permet de les exposer à une chaleur modérée, mais cela veut dire aussi qu’il faut bien les surveiller pour les retirer juste quand ils ont atteint la bonne couleur.
On obtient une poudre parfumée qui n’a plus le mordant du zeste frais, mais ce zeste de citron torréfié compense par une dimension toastée qui le rend presque sucré. On peut s’en servir dans les scones et les biscuits, on peut en mettre dans la pâte à crumble ou le granola, on peut en infuser de la crème ou du lait pour des crèmes brûlées ou des glaces, on peut en saupoudrer les salades de fruits (nectarine et framboise, par exemple), on peut la mélanger avec du sucre pour faire du sucre au citron et avec du thé pour faire du thé au citron, on peut la marier à d’autres épices pour en frotter une viande ou un poisson… les possibilités sont illimitées.
En fait, on peut utiliser la poudre de zeste de citron torréfié dans n’importe quelle recette qui fait appel à du zeste frais — j’ai cherché une exception mais je n’en ai pas trouvé — et je recommande de l’utiliser alors dans la même quantité.
Une fois que vous aurez prélevé le zeste et pressé le jus des citrons, vous pourrez mettre le reste de la peau dans votre carafe d’eau pour lui donner un goût légèrement citronné et rafraîchissant.
Et bien sûr, la méthode peut être appliquée à tout autre agrume.