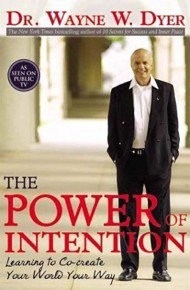Au printemps dernier, nous avons reçu à dîner des amis américains de passage à Paris. L’une d’entre eux travaille pour la revue gastronomique the Art of Eating, et a gentiment pensé à nous en apporter le dernier numéro*.
C’était déjà un chouette cadeau, mais sa valeur a été démultipliée lorsque je me suis installée pour le lire le lendemain et que je me suis aperçue qu’il contenait un article de quatorze pages (quatorze pages !) sur le pain au levain, un sujet pour lequel mon enthousiasme ne faiblit pas. (Voyez donc mon premier billet sur le pain au levain naturel et les recettes au levain naturel qui ont suivi.)
Cet article de quatorze pages (quatorze pages !) est écrit par James MacGuire, un chef et boulanger américain de renom, qui a notamment été éditeur technique pour la traduction anglaise de l’ouvrage de Raymond Calvel, Le Goût du pain.
Après une discussion passionnante sur l’histoire et la technique du pain au levain, MacGuire donne une recette, que je me suis empressée de tester quelques jours plus tard. Ce fut un tel succès que c’est devenu notre pain quotidien, dont je fais un nouvel exemplaire par semaine depuis.
L’originalité de la méthode, c’est qu’il n’y a pas besoin de pétrir la pâte (mais c’est encore différent de ce pain qu’on ne pétrit pas). A la place, la pâte est simplement repliée sur elle-même dans le bol où elle repose, plusieurs fois toutes les heures pendant quatre heures. Ceci permet de développer le gluten et les saveurs, pour obtenir un pain délicieux moyennant un effort minimal.
Pour être claire, je n’ai rien contre le pétrissage, surtout que je me sers généralement de mon robot-pétrin, mais l’animal n’est pas spécialement discret, et cette façon de procéder me permet de démarrer un pain dans le silence des matins de weekend, sans réveiller toute la maisonnée. (Et je sais que je pourrais aussi pétrir à la main, mais j’avoue que je ne prends pas un plaisir fou à pétrir les pâtes à fort taux d’hydratation. Ça m’énerve d’avoir toute cette glu sur les mains.)
Un autre changement par rapport à mes habitudes, c’est que MacGuire recommande un levain à 66% d’hydratation, c’est-à-dire nourri de 2 mesures d’eau pour 3 mesures de farine (en poids) à chaque repas, par opposition à la règle du 50-50 que j’appliquais jusqu’alors. J’ai fait la transition sans problème et pour être honnête, je ne vois pas vraiment de différence dans la vitalité de mon levain, mais j’ai quand même adopté cette façon de faire.
Je fais ce pain avec de la farine T80 dite « bise », qui est le type de farine que MacGuire préconise, et je la coupe généralement avec de la T110 pour une mie plus grise (le pain de la photo est fait avec seulement de la T80). Comme la recette est écrite pour un public américain, MacGuire donne une astuce pour émuler la T80 française — pour une fois que c’est dans ce sens-là, ça fait plaisir — qui consiste à utiliser un mélange de farine ordinaire (dite all-purpose) et de farine complète qu’on aura préalablement tamisée pour retirer une partie du son de blé qu’elle contient.
Le déroulé de la recette demande de bâtir le levain en deux fois la veille du jour de boulange (une fois dans l’après-midi, une fois le soir) puis de préparer la pâte le lendemain matin et de cuire le pain l’après-midi. Evidemment, si on travaille de chez soi (ou qu’on a plein de RTT à rattraper), c’est facile, mais sinon, on peut s’arranger pour caler ça le weekend, en bâtissant le levain le samedi et en faisant cuire le pain le dimanche. J’ai indiqué des heures à titre indicatif, mais il est évident que vous pouvez décaler le tout comme bon vous semble.
Je pense que j’ai encore des progrès à faire dans l’exécution de cette recette : la poussée au four n’est pas toujours la même (mon pain avait d’ailleurs plutôt moins levé que d’habitude le jour où j’ai pris la photo) et j’aimerais bien obtenir une croûte plus épaisse, mais le goût est là et la mie est bien alvéolée, donc je suis déjà ravie.
Je reconnais que je ne fais pas très attention à la température à laquelle j’expose mon levain et la pâte qui fermente (j’ai quand même donné les préconisations de MacGuire ci-dessous), ni d’ailleurs celle de l’eau que je mets dans la pâte, et ce sont des facteurs sur lesquels j’ai l’intention de jouer.
Je terminerai en soulignant que l’article ne se réduit pas à cette recette (vous ai-je précisé le nombre de pages qu’il fait ?) et vous en apprendrez encore plus en lisant les instructions telles que MacGuire les a rédigées. Donc si vous lisez l’anglais et si vous avez moyen de mettre la main sur un exemplaire du magazine, je vous le recommande sans ambages. (D’ailleurs, vous vous doutez sûrement que ce genre de magazine indépendant et sans publicité (!) a toujours besoin d’un abonné de plus.)

Pain au levain : la mie
* Le numéro 83 de Art of Eating peut être commandé sur le site de la revue.
Lire la suite »