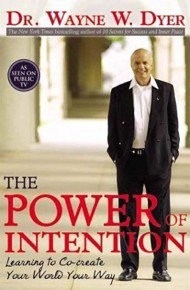Dans les tous premiers jours de cette année, j’ai été reçue à déjeuner chez une amie blogueuse*. En préparation de ce repas, elle m’a dit deux choses bigrement prometteuses : « J’espère que tu aimes la cuisine chinoise » et « J’espère que tu auras faim ! »
Dans son accueillant salon rempli de jolies choses à regarder — des cartes postales des dessins des vieux vinyles et de fins volumes à la couverture douce — elle m’a servi une ribambelle de plats chinois, tous issus du répertoire maternel.
Ces travers de porc rôtis à la cantonaise (siu pai gwat) faisaient partie du menu : lustrés de sauce, bien caramélisés et croustillants aux entournures, mais fondants à coeur, si fondants qu’on pouvait retirer les petits os avec les doigts sans rencontrer aucune résistance. Avec un bol de riz blanc cuit dans son adorable rice-cooker — un modèle aux allures de dînette que je n’ai pas réussi à chasser de mon esprit — c’était un délice absolu.
Lustrés de sauce, bien caramélisés et croustillants aux entournures, les travers étaient fondants à coeur, si fondants qu’on pouvait retirer les petits os avec les doigts sans rencontrer aucune résistance.
Ce qui est chouette, quand on est invité à la table de quelqu’un qui a un blog de cuisine, c’est qu’il y a de fortes chances pour que le plat qu’on vient de manger et d’adorer soit déjà publié sur son site, ou ait vocation à l’être sous peu, si bien qu’il n’est même pas nécessaire de sortir son calepin en demandant la recette.
Et effectivement, celui-là l’était.

Bien que la recette soit très simple — il s’agit juste de faire mariner la viande avant de la faire rôtir au four — il m’a fallu patienter quelques semaines avant de réunir les ingrédients de la marinade. Mais un jour où Maxence et moi nous étions motivés pour une expédition dim sum dans le treizième, un petit tour chez Paris Store m’a permis de mettre la main sur les deux qui me manquaient.
Une semaine plus tard, ayant acheté des travers de porc chez mon boucher**, j’ai entrepris de suivre la recette. J’ai baissé un peu la température du four, et je me suis dit a posteriori qu’il aurait mieux valu couvrir le plat pendant la première partie de la cuisson (comme recommandé ci-dessous) pour éviter une coloration trop rapide, mais à part ça : comme sur des roulettes.
J’ai fait cuire du riz blanc et fait une petite salade de concombre épicée assaisonnée avec du vinaigre de riz, de l’huile de sésame et de l’ail, et nous nous sommes attablés pour un repas d’anthologie.
Le lendemain, je me suis servi du reste de riz et de viande pour faire un riz sauté avec des fanes de radis. J’ai aussi gardé les os au congélateur pour mon prochain bouillon tonkotsu, ravie comme toujours de tirer trois plats différents d’un seul morceau de viande.

Riz cantonais aux travers de porc
* Je lui avais apporté un pain au levain grigné à son initiale — ou plus exactement à l’initiale de son nom de plume — et un petit pot de mon levain. Elle a publié un très beau dessin de ce pain quelques jours plus tard, et s’est ensuite lancée dans ses propres aventures boulangères avec son levain, qu’elle a baptisé Anatole pour une raison qui me ravit.
** Je vous encourage à vous procurer de la viande élevée de façon artisanale auprès d’un fournisseur à qui vous pouvez poser des questions. La quasi-totalité de la viande de porc que l’on trouve en supermarché vient d’élevages intensifs qui ont un impact désastreux sur l’environnement, le bien-être animal et la santé humaine. Pour en savoir plus, vous pouvez par exemple lire Bidoche de Fabrice Nicolino, ou Faut-il manger les animaux ? de Jonathan Safran Foer.