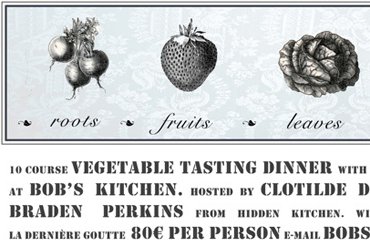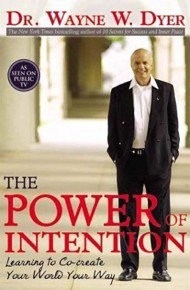Après avoir raté ma visite hebdomadaire au marché pendant des semaines pour différentes raisons, j’ai enfin pu retourner aux Batignolles ce weekend.
C’était le matin idéal pour faire mon comeback. Je m’étais levée tôt, il faisait doux et ensoleillé, et en descendant le boulevard à vélo, les cheveux encore humides de la douche, j’ai été prise de ce sentiment délicieux d’anticipation et d’accomplissement que ne manque jamais de faire naître cette petite expédition du samedi matin : impatience de découvrir ce qu’il y a de beau sur les étals, et certitude que quoi qu’on achète, le weekend ne pourra être que bon, une fois remplis le tiroir à légumes du frigo, la coupe à fruits en forme d’étoile, et le vase vert layette.
J’ai acheté six oeufs frais portant encore quelques traces de là d’où ils venaient, et autant de pêches blanches ; un gros fagot de tiges de rhubarbe, un bouquet de dahlias oranges et vermillon, des tomates bien mûres, et enfin, auprès de mon producteur préféré, des petites aubergines à la peau lisse et brillante — mes premières cette année.
Les aubergines et moi, c’est un peu compliqué : je les adore quand elles sont bien préparées, mais je me méfie alors de la quantité d’huile qu’elles ont sans doute nécessité. Et j’ai longtemps eu un mal fou à les cuisiner correctement, me retrouvant généralement avec un truc spongieux et amer, donc je n’en mangeais pas aussi souvent que je l’aurais souhaité.
Mais avec le temps et l’expérience, j’ai fini par comprendre que 1) j’obtiens de bien meilleurs résultats avec les petites aubergines, de celles qui pèsent au maximum 200 grammes, et 2) qu’on choisisse de les faire griller, rôtir ou sauter, ces demoiselles ont besoin de cuire looooongtemps pour devenir vraiment soyeuses et fondantes.

Salade de tomates à l’aubergine rôtie.