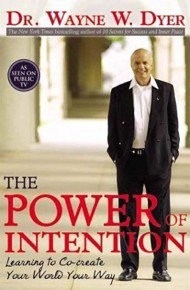Si vous êtes venus dîner chez moi récemment, il y a fort à parier que vous avez été accueillis avec un verre de blanc frais et des crackers garnis de cette tartinade vert gazon. « C’est du guacamole ? » aurez-vous peut-être demandé, et je vous aurai répondu, « Non, c’est du poicamole ! »
J’ai effectivement fait, refait et re-refait cette recette ces dernières semaines : évidemment, ce n’était pas du tout la saison des petits pois (quoique, ça ne devrait plus tarder maintenant), mais j’ai pris l’habitude de garder des petits pois surgelés sous le coude, et cette précaution rend le poicamole extrêmement rapide à préparer.
Les petits pois lui donnent leur goût un peu sucré et leur moelleux, la purée d’amande sa douceur subtile et la coriandre feuille sa fraîcheur. Tartiné sur des morceaux de crackers bio à la farine d’épeautre que je trouve au supermarché, ça donne des bouchées apéro absolument irrésistibles. (Et si j’ai de la chance et qu’il y a des restes, c’est délicieux au déjeuner, avec des carottes râpées et un oeuf mollet.)
C’est en fait une recette que j’ai développée pour le magazine ELLE à table, dans lequel je tiens une rubrique. Elle apparaît dans le numéro qui vient de sortir pour illustrer un sujet sur les points de convergence entre la parfumerie et la cuisine.
Je donne entre autres l’exemple des huiles essentielles, qui ont toujours fait partie de l’arsenal du parfumeur, et ont depuis peu fait leur entrée en version bio et comestible* dans celui du cuisinier moderne, lui permettant d’ajouter à ses plats un parfum frais et puissant d’épice, de fruit, de fleur, ou d’herbe aromatique — ici, de la coriandre feuille — d’une simple pression du compte-goutte**.
En marge de ces expérimentations, j’ai aussi fait une découverte révolutionnaire : on peut faire cuire les petits pois surgelés au rice cooker ! Dans mon modèle Seb ultra-basique qui a une bonne douzaine d’années, il suffit de verser les petits pois dans le bol, refermer le couvercle, et laisser en mode « cuisson » pendant 14 minutes, ou jusqu’à ce que la consistance soit à votre goût. Comme je n’ai pas de cuit-vapeur, je me servais jusqu’ici d’un panier en bambou posé sur une casserole d’eau bouillante, mais cette méthode est plus simple, plus rapide et, dans ma cuisine tout au moins, plus économe en énergie. (Je pense qu’on peut cuire les petits pois frais de la même façon, mais comme ils contiennent moins d’eau j’en ajouterais une larme au fond du bol.)
* La consommation d’huiles essentielles est à proscrire pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les jeunes enfants, et les personnes qui souffrent d’allergies.
** Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter le livre Cuisiner avec les huiles essentielles de Valérie Cupillard (La Plage, 2006).