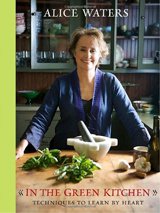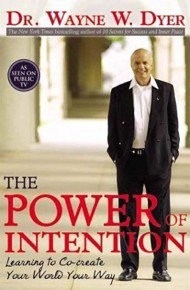La première fois que nous avons goûté aux warabi mochi, c’était au sous-sol du grand magasin Tokyu dans le quartier de Shibuya, à Tokyo. Au beau milieu de cette débauche merveilleuse d’aliments de toutes sortes — sucrés, salés ou un peu des deux, frais, séchés, chauds, froids — une dame se tenait derrière un petit stand, et proposait de faire goûter des petits morceaux d’une pâte souple, recouverte d’une poudre brun clair.
Un coup de pique en bois, un morceau chacun, et une surprise divine. C’était absolument délicieux. En enrobage, j’ai reconnu le kinako, une poudre faite avec du soja grillé et moulu ; l’intérieur, d’une texture fraîche et lisse, offrait un soupir de résistance avant de se dissoudre sur une note délicatement sucrée.
Nous étions tout prêts à en acheter sur le champ, mais la dame a pris la peine de nous expliquer qu’il fallait impérativement les manger le jour-même (avant minuit, sinon ça se transforme en gremlins), et la journée était trop avancée et la boîte trop grosse pour que nous puissions prendre ce genre d’engagement.
Plus tard, lorsque notre voyage nous a menés dans la région du Kansai, nous avons commencé à en voir un peu partout, découpés en petits cubes, en pavés allongés, ou en boules molles, alanguies les unes contre les autres dans la barquette. On s’en est offert (presque) à chaque fois que l’occasion se présentait, sans savoir ce que c’était ni comment ça s’appelait, mais toujours sous les vivats de nos papilles.
Et puis un jour, au marché de Nishiki-dori à Kyoto, la boîte que nous avons achetée avait une belle étiquette, et sur la belle étiquette j’ai pu déchiffrer en hiragana : wa-ra-bi-mo-chi.
Le soir-même, j’ai fait une petite recherche, et j’ai appris qu’il s’agissait effectivement d’une spécialité du Kansai, particulièrement appréciée pendant les mois d’été. Et quoiqu’ils en portent le nom, les warabi mochi ne sont pas des mochi comme les autres, à base de farine de riz gluant (mochiko ou shiratamako). Non, les warabi mochi ne font rien comme tout le monde et sont préparés avec du warabiko, une fécule extraite de la racine d’une variété de fougère particulière.
Dans mon petit carnet de voyage, à la page qui listait tout ce que je voulais rapporter du Japon, j’ai donc écrit: warabiko.
En retournant au marché de Nishiki-dori, j’ai repéré une échoppe qui vendait toutes sortes de poudres et de farines, et demandé s’ils vendaient du warabiko. Ils en vendaient, mais la propriétaire, aidée de sa fille qui ne parlait en fait pas tellement plus anglais que nous japonais, a réussi à nous faire comprendre que le vrai warabiko était très, très cher (de l’ordre de ¥30.000 — 260€ — pour un petit paquet de 300g), mais qu’elles pouvaient nous proposer un substitut plus abordable appelé warabimochiko, du warabiko coupé avec de la fécule de patate douce et de tapioca (¥300 pour la même quantité). Est-ce que ce serait quand même oishii (délicieux) ? Oui, m’ont-elles affirmé avec conviction.
Et effectivement, vu le prix auquel étaient vendus les différents warabi mochi que nous avions mangés, il n’y avait aucune chance pour qu’ils aient été faits avec de la fécule de warabi pure. J’ai donc acheté un sachet de la version low-cost, et la dame m’a gentiment glissé un petit paquet de kinako en cadeau. Après avoir échangé une profusion de arigatos et de légères inclinaisons du haut du buste, nous sommes repartis en flottant à quelques centimètres du sol, ravis de ce petit épisode.
Une semaine à peine après notre retour, j’ai sorti les paquets et je me suis mise au travail. En plus du feuillet d’instructions (en japonais, ça va sans dire) joint à la fécule, j’avais cherché des recettes sur internet, et quoiqu’il n’y en ait que très peu en anglais ou en français, j’avais quand même trouvé assez d’infos pour me sentir prête.
Le déroulé de la recette est très simple : on mélange la fécule avec de l’eau et du sucre, et on fait chauffer ce mélange jusqu’à ce qu’il épaississe. On verse ensuite cette pâte collante sur le plan de travail saupoudré de kinako, avant de la couper en petits morceaux que l’on enrobera à leur tour de kinako. (On peut aussi verser la pâte dans de l’eau glacée au sortir de la casserole, pour une sensation plus fraîche en bouche).
Quelques minutes plus tard, mes warabi mochi étaient prêts ; il n’y avait plus qu’à les laisser refroidir. Armés de cure-dents, nous en avons goûté un morceau, puis deux, puis deux de plus, avec un large sourire : c’était exactement ça ! J’avoue qu’au fond de moi, j’avais un peu de mal à croire que j’allais pouvoir reproduire ces fameux warabi mochi dans ma cuisine parisienne, et pourtant si : c’était précisément le même goût et la même texture que ce que nous avions goûté là-bas.
Evidemment, il manquait le décor japonais, mais nous avons choisi de ne pas trop nous attarder sur ce détail, pour mieux nous concentrer sur les mochi. Et maintenant que j’ai trouvé où acheter du warabimochiko à Paris (voir note en bas de recette), je ne serai pas victime du syndrôme du too good to use* et je pourrai nous faire des warabi mochi dès que la nostalgie s’en fera sentir.
Voir aussi : la recette des daifuku mochi à la fraise.
* En référence à un billet de David Lebovitz, c’est lorsqu’un ingrédient paraît si rare et précieux qu’on n’arrive pas à l’utiliser, et qu’on finit par le laisser se périmer à force d’attendre.
Lire la suite »