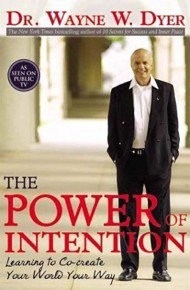Je vivais en Californie depuis quelques mois et je savourais la dotcomitude totale de mon environnement de travail lorsqu’on nous a annoncé la grande nouvelle : on allait faire un barbecue au bureau.
Pour moi, travailler dans la Silicon Valley au tournant du millénaire, c’était exactement ça : une foison de bonnes idées pour que les employés soient heureux (des pistolets à eau ! un babyfoot ! des pizzas aux frais de la princesse le vendredi !) et donc plus enclins à investir leur temps et mobiliser leurs neurones pour faire avancer l’entreprise.
Le jour du barbecue, tout le monde était sur le pont, à mettre en place les ingrédients pour les hamburgers, surveiller la cuisson de la viande (ou des steaks de soja — on était, je le rappelle, en Californie), faire le service des salades (de pâtes ou de pommes de terre), ou aller chercher les derniers retardataires qui se cachaient encore dans leur cubicle, avant de s’installer pour manger sur la terrasse ensoleillée à l’arrière de nos bureaux.
Un cobbler, c’est quelqu’un qui répare les chaussures. Ça n’éclairait pas tellement ma lanterne, alors j’ai insisté : oui, d’accord, mais, euh, pourquoi ? Mes collègues américains se sont alors concertés avec sérieux, la cuillère hésitante et le sourcil froncé, pour finalement reconnaître qu’eh bien, en fait, on ne savait pas trop.
Plusieurs personnes s’étaient proposées pour apporter des desserts, dont un peach cobbler préparé, si mes souvenirs sont bons, par Barbara du service opérations.
Tandis que chacun s’extasiait, j’ai posé la question : c’est quoi un cobbler* ? Ce à quoi on m’a répondu : c’est quelqu’un qui répare les chaussures. (Un cordonnier, donc.) Ça n’éclairait pas tellement ma lanterne, alors j’ai insisté : oui, d’accord, mais, euh, pourquoi ? Mes collègues américains de naissance ou d’adoption se sont alors concertés avec sérieux, la cuillère hésitante et le sourcil froncé, pour finalement reconnaître qu’eh bien, en fait, on ne savait pas trop.
Peu importait : the proof of the pudding is in the eating, comme on sait**, et celui-ci était fort bon.
Le cobbler est l’un de ces desserts très américains qui portent des noms folkloriques — comme le brown betty, le buckle, le grunt, le slump ou le pandowdy — et qui consistent à faire cuire des fruits de saison sous une sorte de pâte. L’inverse de la tarte et la moitié supérieure d’une tourte, en somme, mais en plus facile puisque la pâte en question n’est pas étalée. Le crumble est un exemple du genre, mais il est loin d’être le seul.
Dans le cas du cobbler, on coiffe les fruits d’une pâte qui ressemble à une pâte à scone, dont on dépose des morceaux au petit bonheur la chance, comme sur la photo ci-dessus, ou en disques bien nets, si on préfère (mais je soupçonne que ça ne ressemble à ça que si on utilise de la biscuit dough toute faite vendue en tubes au rayon frais des supermarchés américains).
Le cobbler, ça change du crumble. C’est tout aussi rapide à faire, mais ça offre une plus large palette de textures : la pâte est croustillante à la surface mais reste moelleuse à l’intérieur, et devient fondante là où elle se mêle au jus des fruits.
Comme mon tout premier cobbler était aux pêches, c’est à ce fruit que je l’associe principalement, mais en réalité on peut le décliner avec ce qu’on veut, et j’aime particulièrement la version abricot et myrtille que j’ai servie à des amis venus dîner la semaine dernière.
Je mets de la poudre d’amande dans ma pâte à cobbler pour en accentuer le fondant, et pour aller avec des fruits à noyaux, je la parfume (discrètement) à l’eau de fleur d’oranger. On recommande généralement de servir le cobbler avec une boule de glace à la vanille, mais je suis française et je préfère largement un peu de crème fraîche. Je trouve que ça souligne mieux le sucre naturel des fruits.
Quant au nom, si vous êtes toujours perplexe, sachez qu’il est possible que ça vienne plutôt d’une analogie entre la forme des morceaux de pâte et celle des cobblestones (pavés) ou des cobbles (soit des collines arrondies, soit des morceaux de charbon), mais en fait personne ne sait vraiment — pas même Lynne Olver, une bibliothécaire qui tient un site formidable sur l’histoire des aliments, et qui propose tout de même quelques citations et références permettant de revenir aux origines de ce dessert.
* On prononce simplement « cobleur ».
** Cela se traduit plus ou moins littéralement par « la preuve du dessert est dans l’action de le manger, » ce qui signifie qu’on ne saura si le dessert est bon que quand on l’aura goûté. Plus généralement, c’est un aphorisme qui est utilisé pour mettre fin aux tergiversations, en indiquant qu’on n’aura le fin mot de l’histoire que quand on se sera un peu mouillé. L’expression apparaît aussi sous la forme (erronée, mais néanmoins répandue) « the proof is in the pudding ».