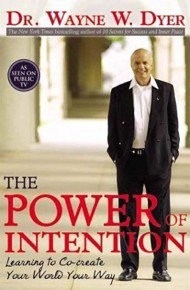Lorsque enfin j’ai récupéré ma cuisine après sept semaines (sept semaines !) de travaux — et encore, on ne faisait refaire que la salle de bain — j’ai commencé par faire un gâteau au yaourt, histoire de nous redonner courage pour notre mission suivante : nettoyer méticuleusement, un par un, la totalité des objets qui se trouvaient à l’intérieur de notre appartement, que nous n’avions pas assez bien protégé de la poussière. (Ils jurèrent, mais un peu tard, qu’on ne les y prendrait plus.)
Dès que notre intérieur a retrouvé son harmonie d’antan, j’ai pu reprendre ma vie culinaire là où je l’avais laissée sept semaines (sept semaines !) plus tôt et, ô bonheur, retourner au marché des Batignolles. « Eh bien, où étiez-vous donc passée ? » m’a demandé mon maraîcher, en remplissant mes paniers de tout ce que l’été avait produit de plus coloré.
J’ai pédalé sur un nuage jusqu’à la maison et, une fois le butin rangé dans mes bacs à légumes resplendissants de propreté (j’en avais profité pour récurer aussi le frigo), j’ai commencé à réfléchir. En particulier, il me fallait faire bon usage d’une ribambelle d’aubergines grosses comme le poing et rutilantes comme des miroirs (ce qui est bien pratique quand l’entrepreneur n’est toujours pas venu poser celui du lavabo).
Voyez-vous, je suis nulle en aubergine. La seule façon pour moi d’arriver à un résultat correct avec ces fruits-là*, c’est de les faire rôtir jusqu’à ce que purée s’ensuive. D’ordinaire, j’en fais ensuite un caviar d’aubergine, dont la recette se trouve d’ailleurs dans mon bouquin, mais cette fois-ci, j’avais envie de quelque chose d’un peu différent.
Il se trouve que je venais de recevoir un exemplaire presse du Book of New Israeli Food de Janna Gur, un livre alléchant qui dépeint la cuisine d’Israël tout autant que ses habitants et leur vie quotidienne. Et à la page 28, l’auteur cite un proverbe arabe qui m’a fait rire : « Si ta future femme ne sait pas accommoder l’aubergine de cinquante façons différentes, dit-il, ne l’épouse pas. »
Janna Gur en propose alors une douzaine, ce qui est sans doute plus que la plupart des gens n’en ont dans leur répertoire culinaire, mais laisse quand même un peu de travail de recherche à qui veut être fin prêt quand, un jour, leur prince arabe viendra.
Parmi les suggestions du livre, on trouve huit mini-recettes de dips et de salades toutes simples et ne nécessitant que quelques ingrédients. Et comme j’avais sous la main du yaourt bio de chèvre, j’étais tout particulièrement emballée par l’Aubergine rôtie au yaourt, qui donnait à peu près ceci : mélangez 480 ml de yaourt à la chair de 2 aubergines rôties ; ajoutez de l’ail émincé, du sel, du poivre et, éventuellement, de la menthe ou de la coriandre ciselée.
J’ai finalement fait un peu différemment — voir ma recette ci-dessous — mais j’ai été enchantée par l’effet du yaourt, qui donne à ce dip une onctueuse légèreté. Et comme les aubergines s’apprêtent à faire leurs valises pour prendre leurs quartiers d’hiver, je ne peux que vous enjoindre d’en retenir quelques-unes par le pédoncule, et de leur faire subir ce délicieux traitement.
* Petit rappel de l’oncle botaniste : l’aubergine est un fruit, tout comme la tomate, la courgette, ou l’avocat.